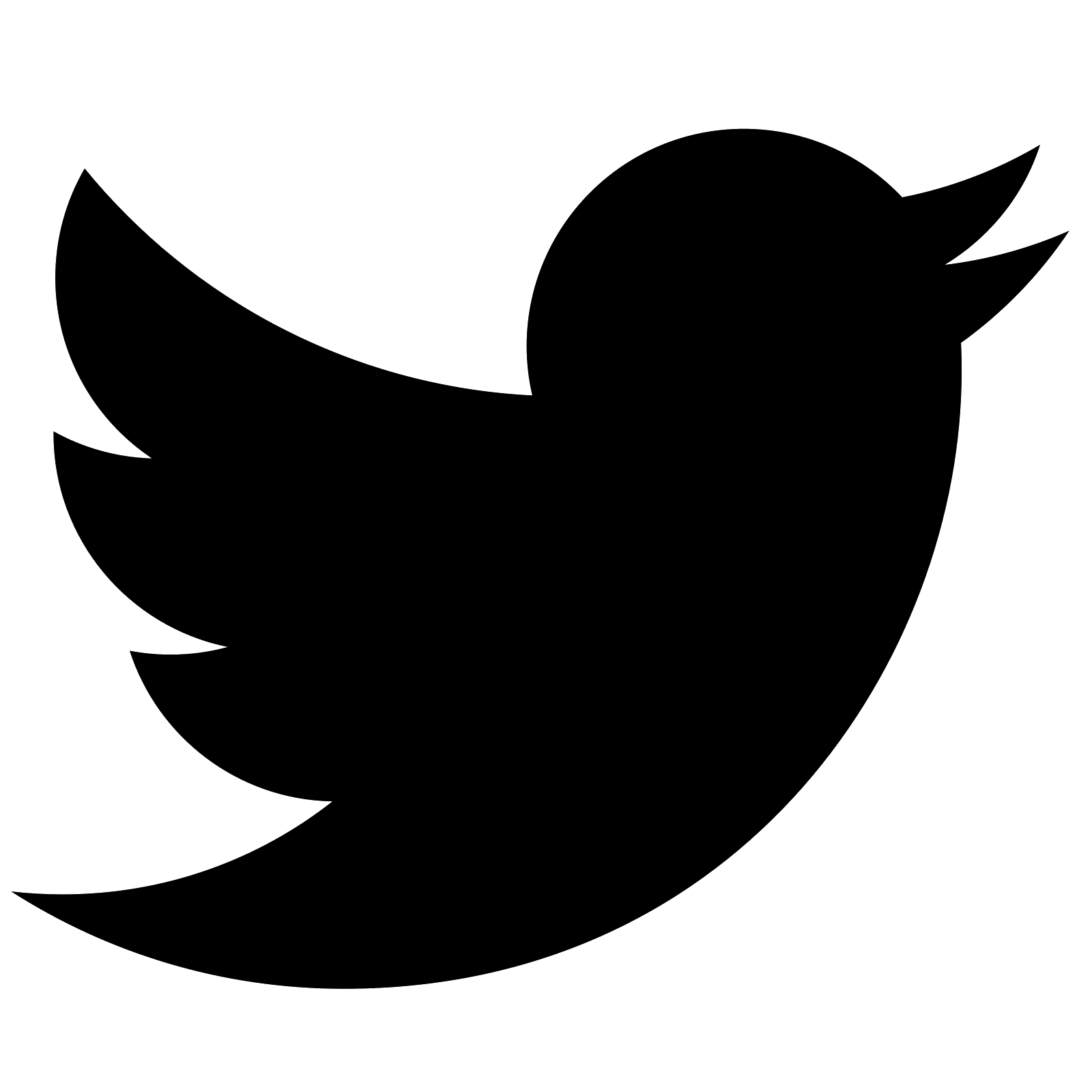Voyage
Au XVIIe siècle, les bateaux européens s’armaient pour la pêche à la morue, traversant l’Atlantique pour rejoindre Terre‐Neuve ou Cape Cod. Ces rivages sur lesquels échouaient certains candidats à ce qu’on appelait alors la « grosse aventure » ont perdu leur rudesse mythologique, pas leur pouvoir d’attraction. Sur les dunes, parmi les herbes à outardes, se nouent toujours de belles histoires.
12h12. Mon crayon vient de s’arrêter au milieu de la case, impérieux, me sommant de répondre à la question qui me tarabuste depuis des semaines : « Faut‐il tenir les promesses faites aux morts ? » Et moi de lui répondre : « Franchement, crayon ? Non. Enfin, pas forcément. De toute façon, le défunt ne s’en rend pas compte, et après tout, c’est lui qui est parti, pas nous. Tu sais ce que c’est, on a tous tendance à s’engager un peu vite face à la mort, comme si le serment pouvait prolonger la vie, mais on le sait bien, au fond, que ce n’est qu’un engagement de soi à soi, qu’on ne fait qu’essayer de se convaincre que notre souvenir est plus fort que celui des milliards d’individus qui nous ont précédés, etc. »

Pourtant, plus je tente de me donner bonne conscience en empilant les couches de mauvaise foi, plus le visage de ma grand‐tante Lolita m’apparaît distinctement : ses 92 ans, sa peau parcheminée, son Brushing, ses dents blanches, son caniche royal, oui, Cape Cod, oui, elle m’a fait promettre d’aller disperser ses cendres devant sa maison construite sur un banc de sable de Chatham, cette maison folle que l’océan, bientôt, engloutirait mais qu’elle avait toujours refusé de détruire malgré l’insistance du gouvernement.
En vérité, je suis indéfendable. Voilà trois ans qu’elle est morte et que je la garde enfermée dans son petit pot de céramique. Elle m’a laissé de quoi vivre pendant plusieurs années et je tergiverse encore à accomplir sa dernière volonté, rien de plus qu’un aller‐retour à Boston. Deux semaines plus tard, j’ai terminé mes illustrations pour le magazine et je survole l’océan avec le souvenir et les cendres de cette femme que j’adorais. Née Benatar, à Cordoue dans le premier quart du siècle dernier, elle avait changé son prénom – Dolores – en Lolita pour ne pas avoir à porter la responsabilité des larmes. Elle aimait la joie, ce n’était pas une pose, et l’argent, qu’un second mariage heureux et court lui avait assuré. Après la mort de son mari, diplomate en poste à Boston au début des années 30, sentant l’oppression antisémite grandir en Europe, elle avait choisi de demeurer aux États‐Unis et n’était venue en France qu’à la fin des années 50 pour ne plus cesser de voyager jusqu’à sa mort.
Bien que toujours entre deux avions, elle était parisienne jusqu’au bout des ongles. Elle vivait seule, mais ne s’était jamais lassée de la compagnie des hommes. Elle les connaissait par cœur, aimant leurs travers autant que leurs qualités. Je me souviens de la dernière fois où je l’avais vue, peu de jours avant qu’elle n’entre à l’hôpital, lorsqu’elle m’avait dit, très sérieuse en avisant, derrière ses lunettes de soleil, un homme portant un bouquet de roses rouges : « Une chose est sûre : si un amant vous offre des roses rouges, il vaut mieux changer de vie. Soit on n’a aucun goût pour choisir les hommes, soit on n’a pas de chance, mais dans les deux cas, ce n’est pas supportable. »

En me souvenant ainsi de ma grand‐tante, et bien qu’il ne me soit jamais venu à l’esprit d’offrir des roses rouges à l’une de mes maîtresses, je comprends pourquoi je suis si souvent désemparé face aux femmes. Celles que j’aime sont toujours de la race de Lolita, libres et beaucoup trop fortes pour moi. Ne sachant manœuvrer parmi leurs tourbillons, je m’aliène tant et si bien qu’à 40 ans et autant de cigarettes par jour, je préfère désormais payer pour l’amour et monnayer mes lâchetés, confiant au Prozac et aux billets de 50 € le soin de me préserver des chutes. En posant le pied à Boston, après seulement six heures de vol, je dois d’ailleurs me rendre à l’évidence : mon besoin d’amour résiste mal à quelques heures d’absence.

Le lendemain, je me réveille dans la lumière encore frêle de Cape Cod
Depuis la terrasse de ma suite au Chatham Bars Inn, la vue sur le banc de sable qui protège la baie paisible de Chatham est imprenable. Au fond, face à l’océan, les pieds posés dans le jupon des vagues : la maison de ma grand‐tante. J’imagine que la décoration doit ressembler à celle de ma chambre, accumulant les bibelots dans un amalgame de tissus fleuris et quelques fauteuils Adirondack d’où jauger l’horizon. Je songe à ses journées passées ici, à relire les romans de Sagan ou les pièces de Théophile de Viau, Scarron et Hardy qu’elle aimait tant. En pause devant l’Atlantique, à quoi pouvait-elle penser sinon à repartir, elle qui incarnait si justement ce vers de Valéry : « La mer, la mer, toujours recommencée ! »

J’ai prévu de faire la traversée en début d’après‐midi. En attendant, je me suis attablé pour dessiner, croquant la bourgeoisie démocrate de Boston venue se détendre en pull pastel. L’atmosphère de l’hôtel est agréable, presque caricaturale. Tellement Hyannis Port, so Kennedy. Les gens sont charmants. Pour autant que je m’en souvienne, le grand hall servant de réception est organisé autour d’une large table ronde et de bergères en chintz. A l’opposé du restaurant, nappé de blanc, les boiseries en bois fumé du bar rappellent vaguement la grande époque des épopées maritimes. L’essentiel se joue dehors, parmi les fleurs du jardin. Tout à mes dessins, je ne remarque pas la gamine venue s’asseoir à la table voisine. Ses crayons‐feutres déballés, elle gribouille tranquillement un album de Mickey. Comme je la regarde se concentrer sur les oreilles de Pluto, elle me lance :
« Je fais comme toi, mais en mieux.
– Tu as raison. Je n’arrive pas aux chevilles de Walt Disney.
– Je ne suis pas Walt Disney, me répond‐elle. Je suis Thelma.
– Ok. Bonjour Thelma. Enchanté. Moi, c’est Rodolphe. »
Nous avions repris nos activités respectives depuis près d’une demi‐heure lorsqu’une femme, brune et belle dans une longue veste de jersey, se précipite sur Thelma et l’embrasse frénétiquement, visiblement paniquée de l’avoir perdue de vue. Elle la serre contre elle plusieurs fois, presque en larmes, la petite demeurant plutôt sourde à ces assauts de tendresse. Les présentations faites, je me permets de les inviter à déjeuner. La femme se nomme Hester. Elle est belle, en effet. Brune sans forcer, les yeux clairs, de jolis seins, une silhouette de parfaite élégance. Elle me dit qu’elle est attachée parlementaire et vit à Boston, qu’elle n’est ici que pour quelques jours de vacances et que son compagnon, qui n’est pas le père de sa fille, mort dans un accident de la route, doit revenir la chercher. La conversation dérive rapidement sur son enfance, les étés dans la maison de famille de Cape Cod, entourée de ses frères et sœurs. « Des temps heureux jusqu’à la mort de ma mère », me glisse‐t‐elle avec quelques banalités sur la vie. L’ombre du souvenir ne s’attarde pas. Elle s’amuse des gens qui nous entourent, plaisante de tout, surtout de moi, qui lui semble un animal bien étrange. Pourtant, ses sourires masquent mal ses insomnies. Ne quittant pas Thelma du regard, elle semble fébrile, à bout de nerfs, comme traquée. Je ne peux m’empêcher de penser à Miller, qui voyait l’Amérique pleine de gens en fuite. Lorsque je lui raconte l’histoire de Lolita et de ma venue à Chatham, elle n’en croit pas ses oreilles. « C’était celle de votre tante ! L’été, mon père nous emmenait souvent jouer sur Monomoy, autour de cette maison toujours vide. Il passait son temps à redresser les perchoirs à oiseaux sur la dune. » L’anecdote me fait sourire et j’étais déjà très amoureux d’Hester ; elles seraient toutes deux de la traversée.

A l’heure convenue, je frappe à la porte de la chambre. Hester l’entrouvre, me demandant de patienter le temps de préparer Thelma. A peine ai‐je le temps d’apercevoir un bouquet de roses rouges posé sur la commode que Thelma me saute dessus, apparemment ravie de partir en expédition. Nous rejoignons Captain Tim, vieux loup de mer reconverti au service des plaisanciers du Chatham Bars Inn. Il ne sait pas d’où vient le nom Monomoy, sans doute le nom d’une princesse wampanoag de la tribu Nauset. Peut‐être même est‐ce elle qui accueillit les immigrés du Mayflower le 11 novembre 1620.
« Le banc de sable a longtemps été habité. Par les Indiens, puis les colons et les pêcheurs de morue. Il y avait un village au bout de la presqu’île, me dit‐il. A la fin du XIXe siècle, l’endroit était devenu infréquentable à cause de la violence des marins, puis une partie du banc a été emporté par un ouragan. Tout a été abandonné. Cela en dit long sur l’histoire des États-Unis.
– Comment cela ?
– Ce pays s’est construit dans le sang. Il ne connaît qu’une vitesse : la ruée ! Les gens ne font attention à rien. Ils polluent sans vergogne, puis regardent les ravages des changements climatiques en affirmant : “C’est Mère Nature !” Mère Nature ? mon œil ! C’est comme cette dune, là, voyez. A la prochaine tempête, elle sera emportée par l’océan. La baie de Chatham va bientôt disparaître. Personne ne se dit : “Tiens, on a peut-être un peu exagéré avec Mère Nature. On pourrait faire plus attention.” Non ! Ils s’en foutent ! Ils continuent de se comporter comme des porcs ! »

J’écoute d’une oreille Captain Tim déverser son amertume. Je ne réponds rien, même si je peux difficilement lui donner tort. Je préfère songer à Lolita. Les pilotis de sa maison sont battus par les vagues. La mer, la mer, toujours recommencée ! A l’intérieur, l’atmosphère est telle que je me l’étais imaginée, mais je me sens perdu dans cette bicoque chargée du souvenir de ma grand‐tante. Hester le comprend, qui me regarde d’un œil attendri pendant que Thelma s’amuse avec quelques bibelots. Je suis heureux de les savoir avec moi. Je ressors muni du cylindre dans lequel j’ai glissé les cendres de Lolita. La lumière est si pure qu’elle semble photographiée, comme si le ciel était une immense feuille de papier Fresson. J’entrouvre le tube et le vide dans l’écume. Rien de solennel, à l’image de ce qu’était Lolita. Laisser à la mer le soin de toujours recommencer. Lorsque je regagne la maison, Hester vient à ma rencontre et me tend une photo : « Rodolphe ! C’est ma mère, Rebecca ! Ta tante connaissait ma mère ! » Je ne comprends rien à ce qu’elle me raconte. Me montrant le bureau : « Là ! la photo dépassait de ces cahiers ! »
Les blocs multicolores sont empilés sur un coin du secrétaire. Sur la première couverture, on peut lire : « Journal de Cape Cod. 1956-1960. »
« En quelle année est morte ta mère ? demandé‐je à Hester.
– J’avais 6 ans, en 1982. Le 18 avril. »
La couverture du cahier de l’année 1982 est bleue. Avril, mai, juin, juillet. A la date du 12 juillet, Hester me montre du doigt le prénom Jonathan.
« 12 juillet. Au bar du Chatham Inn, j’ai rencontré un très bel homme, charmant. Jonathan Prynne. Je me suis sentie très attirée par sa présence, même s’il m’apparaissait profondément triste. Il m’a confessé qu’il est très affecté par la disparition de sa femme Rebecca, survenue brutalement au printemps. Il m’a longuement parlé d’elle. Touchée par son histoire, je me suis sentie portée par la nécessité impérieuse de lui venir en aide. Il y a longtemps que je n’ai pas pratiqué la voyance, mais je lui ai proposé de venir me retrouver ici avec une photo d’elle. Peut-être se passera-t-il quelque chose. Peut-être rien. Peut-être ne viendra-t-il pas.
13 juillet. Jonathan est venu cet après-midi. Il m’a donné une photo de Rebecca. Je suis prise de flashs très violents. Rebecca n’a pas encore effectué son voyage. Elle est partie trop vite. Elle a encore beaucoup de choses à dire à son mari et à ses enfants. Elle souhaite que je lui rende cet ultime service. La séance a été très longue et éprouvante. J’ai demandé à Jonathan de revenir dans deux jours.
14 juillet. Rebecca revit à travers moi. Le temps que durera son passage. C’est une femme très douce… »

Hester ne peut retenir ses larmes. Cette nuit, nous la passons ensemble, à lire le récit de ces six mois pendant lesquels sa mère avait apaisé son âme grâce au secours de Lolita. Là, sur cette dune perdue de Cape Cod, face à l’océan, nos vies semblent désormais liées. Je lui propose de m’accompagner en France avec sa fille. De venir vivre avec moi. Elle me répond que rien ne la retient ici depuis la mort du père de Thelma, qu’elle ne souhaite pas se rendre dépendante de son amant, un homme très riche qu’elle n’aime pas. A cet instant, tout me semble possible.
La laissant au matin devant la réception du Chatham Bars Inn, je l’assure que ma proposition tient toujours et lui propose de me retrouver à 11 heures dans le hall de l’hôtel pour rentrer à Boston ; nous aurons le temps de passer chez elle préparer quelques affaires avant de prendre l’avion prévu à 22h47 pour Paris. A 11h30, j’ai compris que j’avais perdu la partie.
En rejoignant ma voiture sur le parking, j’avise une énorme berline noire, stationnée devant l’entrée. Par la fenêtre, posés sur le siège arrière, deux sacs de voyage d’où dépasse un cahier de coloriages Mickey. Mon cœur se brise, une fois de plus. Je n’y prête pas plus attention qu’à une mauvaise habitude. La mer, la mer, toujours recommencée ! Épilogue : Aéroport de Boston. Il est 22h30. Les passagers du vol Delta 247 à destination de Paris sont priés de se présenter à la porte d’embarquement. Une voix dans mon dos : « Je devais passer prendre mon passeport. »

Lire aussi
En route pour Big Sur, sur les traces de Jack Kerouac
Les bons plans de The Good Life à Big Sur
Goa, le repaire des hippies 2.0 – 1/2